De nombreux agents infectieux sont transmis par l'intermédiaire
d'un vecteur, insecte ou acarien. Leur rencontre avec l'hôte est de
ce fait facilitée, tout en présentant l'avantage de limiter
le "gâchis" de microorganismes dispersés inutilement
dans la nature. L'agent infectieux, ses hôtes vertébrés,
son ou ses vecteurs, constituent ce que l'on appelle un système
vectoriel. La réussite de ce système complexe dépend
étroitement des conditions bio-climatiques rencontrées dans
son écosystème.
La contamination du vecteur se produit généralement à
l'occasion d'un repas de sang sur un hôte réservoir (si l'on
excepte la transmission verticale). L'agent infectieux se développe
alors plus ou moins rapidement, dans des sites précis de l'organisme
de l'arthropode, durant une période appelée "incubation
extrinsèque". Le vecteur ne sera capable de transmettre l'agent
pathogène à son hôte vertébré qu'après
cette période.
Pour que ce cycle puisse s'accomplir, il est encore nécessaire
que le vecteur vive suffisamment longtemps et qu'il puisse transmettre l'agent
pathogène à un hôte réceptif. C'est à ce
niveau que les conditions rencontrées dans un écosystème
donné revêtent la plus grande importance. Le vecteur doit pouvoir
y être abondant et vivre en contact étroit avec une densité
suffisante d'hôtes réservoirs et de vertébrés réceptifs.
De plus, les conditions climatiques doivent être favorables, comme le
montrent bien les variations d'activité vectorielle selon les années.
![]()
Un écosystème est un ensemble écologique constitué
d’un milieu géophysique abiotique, et d’une biocénose. La biocénose
représente l’ensemble des êtres vivants qui peuplent ce milieu,
ainsi que leurs interactions.
![]() Phytocénose
Phytocénose
Durant leur développement et leur quête, les tiques ont besoin
d’une hygrométrie supérieure ou égale à 80 %.
Une telle hygrométrie suppose que les tiques vivent dans des zones
possédant une bonne couverture végétale et un épais
tapis de feuilles mortes. Ce sont donc les forêts
caducifoliées hétérogènes et les écotones
hébergeant des petits et des grands mammifères en quantité
suffisante qui répondent le mieux aux conditions requises à
la prolifération des tiques. Cependant B. Doche indique que le caractère
de bio-indicateur de la végétation peut varier d’une région
à l’autre, et la présence d’Ixodes en forêt de
conifères reste possible, dans la mesure où il persiste une
quantité suffisante de feuilles mortes au sol pour maintenir l’hygrométrie
nécessaire [9]. Les jardins bien entretenus, tondus et débarrassés
régulièrement de leurs feuilles mortes ne constituent pas un
habitat très favorable pour les tiques et les micromammifères.
![]() La
zoocénose [10]
La
zoocénose [10]
L’habitat des Ixodes doit contenir une concentration et une variété suffisantes d’hôtes vertébrés pour pouvoir les nourrir à leurs différentes stases, qu’il s’agisse des larves, des nymphes, ou des femelles adultes. Les formes immatures se nourrissent surtout sur les petits vertébrés à sang chaud, de préférence des rongeurs, alors que les adultes se gorgent sur les grands mammifères.

![]()
- Il est établi aussi qu'ils disséminent des tiques vectrices
d'autres pathogènes tels que Rickettsia mongolotimonæ,
R. africae ou le virus Congo-Crimée.
Les migrations constituent d'ailleurs l'explication la plus plausible à la répartition
des différents génotypes de Borrelia
[323], à l’extension du TBEV [324] et
à celle d’espèces d’Ehrlichia [325].
répartition
des différents génotypes de Borrelia
[323], à l’extension du TBEV [324] et
à celle d’espèces d’Ehrlichia [325].
En outre, le stress migratoire des oiseaux favoriserait la réactivation de borrélioses de Lyme latentes [326].
La dissémination de tiques aviportées tout au long des principales routes migratoires passant par l'Europe constitue également l'hypothèse la plus probable pour expliquer les répartitions géographiques d'autres agents pathogènes transmis, tels que le virus Thiafora-Erve.
- Les routes migratoires des oiseaux passant par la France
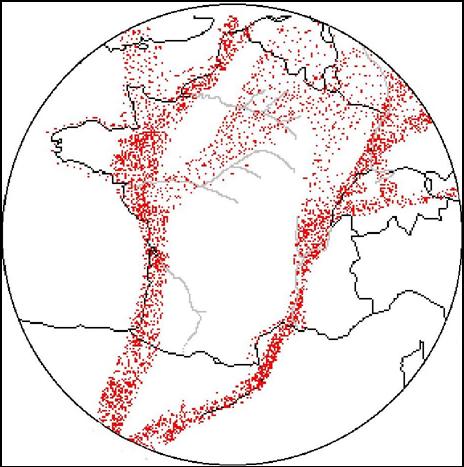
La France est située sur la branche occidentale du système de migration de trois milliards d’oiseaux se rendant des régions paléarctiques vers les régions afro-tropicales.
Les deux cartes présentées dans ce paragraphe concernent les couloirs migratoires en France ; elle ne sont proposées qu'à titre indicatif, car la réalité est beaucoup plus complexe. Chaque espèce, et souvent même, chaque population géographique d'une même espèce, migre suivant des modalités qui lui sont propres.
La carte ci-dessus, indique grossièrement les couloirs les plus fréquemment empruntés en France.
La carte ci-dessous a été publiée par l'AFSSA (Avis N° 2006-SA-0053 du 14 02 06), afin de délimiter des zones à risque de contact entre des oiseaux migrateurs potentiellement infectés par un virus influenza hautement pathogène et des oiseaux d’élevage. Cette carte ne prend en compte que les aires de repos et les aires de gagnage (alimentation) des oiseaux d’eau, elle apporte cependant de précieuses informations sur les zones où les tiques peuvent être échangées [330].

![]() Pathocénose
et cycles enzootiques
Pathocénose
et cycles enzootiques
L'épidémiologie des maladies vectorielles à
tiques est particulièrement complexe. Selon les régions, d'autres
vecteurs possédant les mêmes hôtes, sont impliqués
dans la transmission des mêmes agents pathogènes.
 Dans
le cas de la borréliose de Lyme, il s'agit essentiellement d'espèces
de tiques appartenant au complexe d' I. ricinus : Ixodes hexagonus,
ou I.uriae. Cependant d'autres espèces se montrent susceptibles
d'entretenir des cycles. Des tiques comme I. trianguliceps, I. canisuga,
I. acuminatus, I. frontalis, Dermacentor reticulatus, Haemaphysalis
punctata et H. concinna. Des insectes diptères pourraient
aussi agir en tant que vecteurs secondaires (Tabanidés, Culicidés,
B. afzelii a été isolée chez Aedes vexans).
Dans
le cas de la borréliose de Lyme, il s'agit essentiellement d'espèces
de tiques appartenant au complexe d' I. ricinus : Ixodes hexagonus,
ou I.uriae. Cependant d'autres espèces se montrent susceptibles
d'entretenir des cycles. Des tiques comme I. trianguliceps, I. canisuga,
I. acuminatus, I. frontalis, Dermacentor reticulatus, Haemaphysalis
punctata et H. concinna. Des insectes diptères pourraient
aussi agir en tant que vecteurs secondaires (Tabanidés, Culicidés,
B. afzelii a été isolée chez Aedes vexans).
Le cycle épidémiologique de la fièvre boutonneuse se
montre tout aussi complexe, autorisant des contaminations humaines tant dans
le cycle domestique, que dans le cycle sauvage.
L'existence de cycles épidémiologiques complexes est probablement
la règle pour de nombreuses autres maladies vectorielles à tiques.
Schématiquement, on peut dire que les modifications de l’écosystème tiennent à trois grands types de facteurs: anthropiques, naturels et socio-économiques [200].
 L’agriculture
L’agriculture
La sylviculture
 La
France métropolitaine compte 15 millions d’hectares de forêt,
soit un peu plus du quart de sa superficie. Elle continue même à
se reboiser depuis la loi anti-érosion de 1882 (400.000 hectares)
et les travaux de reboisement des « zones rouges » (lieux des
combats de la Première Guerre mondiale). Autour de Verdun quelques
dizaines de milliers d’hectares ont été ajoutés au
domaine.
La
France métropolitaine compte 15 millions d’hectares de forêt,
soit un peu plus du quart de sa superficie. Elle continue même à
se reboiser depuis la loi anti-érosion de 1882 (400.000 hectares)
et les travaux de reboisement des « zones rouges » (lieux des
combats de la Première Guerre mondiale). Autour de Verdun quelques
dizaines de milliers d’hectares ont été ajoutés au
domaine.
Jusqu’aux années 60, les communes rurales se contentaient de l’exploitation
tournante de coupes de bois dans des taillis sous futaies, tous les 25 à
30 ans. Il n’existait pas d’ouvertures importantes dans les forêts,
la luminosité était médiocre dans les sous-bois, et
la régénération était spontanée. Ce type
d’exploitation ne répondant plus aux besoins, l’Office National des
Forêts (ONF) procède au rajeunissement des peuplements. Des
surfaces importantes de forêt sont entièrement coupées
afin de la régénérer, soit de manière naturelle,
soit par plantation. Depuis 25 ans, le quart des forêts communales
a ainsi été remanié. L’augmentation des surfaces de
semis est un facteur très favorable au développement des animaux
et des tiques; les auteurs américains la citent comme étant
associée à la prolifération des cervidés, des
tiques et des maladies qui leur sont liées.
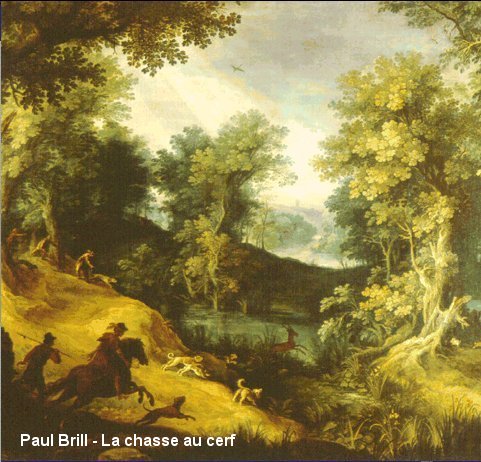 Dans
les forêts domaniales, l’ONF en liaison avec l’Office National de
la Chasse (ONC) et les fédérations de chasseurs, élabore
une politique de la chasse, et entretient délibérément
des taillis sous futaie et des parcelles de régénération
pour satisfaire les besoins alimentaires des animaux [11]. Les
revenus annuels des locations des forêts domaniales s’élèvent
environ à 30 millions d'euros, pour un nombre régulièrement
croissant de grands animaux abattus.
Dans
les forêts domaniales, l’ONF en liaison avec l’Office National de
la Chasse (ONC) et les fédérations de chasseurs, élabore
une politique de la chasse, et entretient délibérément
des taillis sous futaie et des parcelles de régénération
pour satisfaire les besoins alimentaires des animaux [11]. Les
revenus annuels des locations des forêts domaniales s’élèvent
environ à 30 millions d'euros, pour un nombre régulièrement
croissant de grands animaux abattus.
La chasse
Avec la disparition des grands prédateurs, la gestion des grands mammifères est devenue exclusivement humaine. Les Fédérations Départementales de Chasseurs et l’ONC, par le biais de plans de tir et le contrôle des prédateurs, ont favorisé un accroissement exponentiel de la population du gros gibier dans toute le pays. En Meuse, de 1980 à 1998, les prélèvements de gibier ont quadruplé pour les chevreuils et plus que décuplé pour les sangliers. La prolifération des ongulés représente le facteur essentiel de la prolifération des tiques; de plus, la limitation des prédateurs a parallèlement favorisé un accroissement des populations de petits mammifères sur lesquels elles se nourrissent à leurs stases pré-imaginales.


Évolution annuelle des prélèvements
en chevreuils (à gauche) et sangliers (à droite).
(Données de l'Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage de 1970 à 2000, voir Gestion
de la faune sauvage)
Aménagement du territoire
 Les
phénomènes saisonniers de migration des animaux participent
à la dissémination des maladies. Les oiseaux surtout, parsèment
les couloirs migratoires de parasites et de leurs agents infectieux. Ces
dernières décennies ont vu la création de parcs naturels
régionaux, de réserves ornithologiques et de grandes retenues
d'eau servant à alimenter les canaux, à alimenter les villes
en eau potable, à réguler les crues ou à refroidir
les centrales électriques.Les grandes retenues d'eau ne gèlent
pratiquement plus, provoquant un microclimat autour d'elles, sur une frange
de quelques kilomètres. Situées sur les grandes voies migratoires,
elles reçoivent de très grandes quantités d'oiseaux
de passage et nombreux sont ceux qui maintenant trouvent des conditions
favorables pour hiverner.
Les
phénomènes saisonniers de migration des animaux participent
à la dissémination des maladies. Les oiseaux surtout, parsèment
les couloirs migratoires de parasites et de leurs agents infectieux. Ces
dernières décennies ont vu la création de parcs naturels
régionaux, de réserves ornithologiques et de grandes retenues
d'eau servant à alimenter les canaux, à alimenter les villes
en eau potable, à réguler les crues ou à refroidir
les centrales électriques.Les grandes retenues d'eau ne gèlent
pratiquement plus, provoquant un microclimat autour d'elles, sur une frange
de quelques kilomètres. Situées sur les grandes voies migratoires,
elles reçoivent de très grandes quantités d'oiseaux
de passage et nombreux sont ceux qui maintenant trouvent des conditions
favorables pour hiverner.

L’action mécanique du vent est un facteur jouant un rôle très important dans les modifications de l’écosystème, elle influe sur la présence de la pluie ou du brouillard, mais aussi sur la dissémination des insectes ailés et les spores de champignons. Il a aussi été démontré que le vent transporte Coxiella burnetii sur des kilomètres. (voir au chapitre fièvre Q).
Les
grandes tempêtes du 3 février 1990 et du 26 décembre
1999, ont dévasté une partie importante de la surface boisée
de notre région. Celle de 1999 a fauché environ 110 millions
de mètres cubes de bois en France, dont 26 pour la seule Lorraine.
Par endroits le volume de bois abattu équivaut à 8 ou 10
années d’exploitation. Les dégâts occasionnés
sont tels que les zones sinistrées doivent être régénérées,
en plus du programme de rajeunissement déjà établi.
Les systèmes vectoriels sont sensibles au climat
et à ses variations. Les modifications climatiques peuvent influer
sur les 3 composants du système vectoriel :
![]() sur
l'agent infectieux lui-même, en sélectionnant des populations
mieux adaptées aux conditions environnementales. Voire en modifiant
leur virulence.
sur
l'agent infectieux lui-même, en sélectionnant des populations
mieux adaptées aux conditions environnementales. Voire en modifiant
leur virulence.
![]() sur les vertébrés réservoirs et hôtes, en modifiant
leur abondance, leur répartition géographique ou leur éthologie.
sur les vertébrés réservoirs et hôtes, en modifiant
leur abondance, leur répartition géographique ou leur éthologie.
![]() sur
les vecteurs, en modifiant leur abondance, leur répartition géographique
et la durée de leur cycle de développement. La durée
de l'incubation extrinsèque et la transmission pourraient en être
modifiées.
sur
les vecteurs, en modifiant leur abondance, leur répartition géographique
et la durée de leur cycle de développement. La durée
de l'incubation extrinsèque et la transmission pourraient en être
modifiées.
 Un
réchauffement global du climat favoriserait l'accroissement de
la population de rongeurs, donc la pullulation des tiques [12].
Il élargirait la période d'activité des tiques et
modifierait leur comportement selon l'hygromètrie. Dans les zones
où le degré de synchronisation est le plus élevé
entre les larves et les nymphes, des phénomènes de co-repas
(cofeeding)
sont décrits, avec le TBEV et Borrelia burgdorferi.
Un
réchauffement global du climat favoriserait l'accroissement de
la population de rongeurs, donc la pullulation des tiques [12].
Il élargirait la période d'activité des tiques et
modifierait leur comportement selon l'hygromètrie. Dans les zones
où le degré de synchronisation est le plus élevé
entre les larves et les nymphes, des phénomènes de co-repas
(cofeeding)
sont décrits, avec le TBEV et Borrelia burgdorferi.
Le réchauffement conduit déjà à un redéploiement
géographique des espèces de tiques vers le nord et en altitude.
On le constate avec la collecte d'I. ricinus à des altitudes
pouvant atteindre 1500 m par endroits [336] ; avec la montée de Rh. sanguineus
au delà de la Loire, ou avec l'extension des zones d’enzootie
de babésiose canine à Babesia canis, 150 km au delà
de la précédente estimation de la limite de répartition
[301].
 L'exposition
aux maladies vectorielles à tiques est proportionnelle à
l'abondance des nymphes. L'abondance des nymphes dépend quant à
elle, de l'importance des populations de rongeurs, qui elle-même
est étroitement dépendante de l'abondance de la nourriture.
R. Ostfeld et al. sont parvenus à démontrer expérimentalement
que la production de glands contituait un facteur prédictif important
de la survenue de maladies vectorielles à tiques deux ans plus
tard. La première année les rongeurs prolifèrent,
puis l'année suivante ce sont les nymphes [233]. En
réduisant la production de glands, la prolifération de parasites
du chêne devient également un facteur limitant la survenue
du risque [234]. En Amérique du Nord, le meilleur réservoir
de la maladie est constitué par la souris à pattes blanches
(Peromyscus leucopus), qui prolifère en de nombreux endroits.
Le même auteur suggère que la biodiversité limiterait
le risque, par effet de dilution. Les tiques devraient en effet se gorger
sur d'autres hôtes dont les capacités de réservoir
sont moins performantes, faisant de facto baisser la prévalence
de l'infection chez les tiques [235, 309].
L'exposition
aux maladies vectorielles à tiques est proportionnelle à
l'abondance des nymphes. L'abondance des nymphes dépend quant à
elle, de l'importance des populations de rongeurs, qui elle-même
est étroitement dépendante de l'abondance de la nourriture.
R. Ostfeld et al. sont parvenus à démontrer expérimentalement
que la production de glands contituait un facteur prédictif important
de la survenue de maladies vectorielles à tiques deux ans plus
tard. La première année les rongeurs prolifèrent,
puis l'année suivante ce sont les nymphes [233]. En
réduisant la production de glands, la prolifération de parasites
du chêne devient également un facteur limitant la survenue
du risque [234]. En Amérique du Nord, le meilleur réservoir
de la maladie est constitué par la souris à pattes blanches
(Peromyscus leucopus), qui prolifère en de nombreux endroits.
Le même auteur suggère que la biodiversité limiterait
le risque, par effet de dilution. Les tiques devraient en effet se gorger
sur d'autres hôtes dont les capacités de réservoir
sont moins performantes, faisant de facto baisser la prévalence
de l'infection chez les tiques [235, 309].
![]() Facteurs
sociologiques et culturels
Facteurs
sociologiques et culturels
Les transformations de notre mode de vie favorisent le temps libre et les loisirs. Nombreux sont les citadins qui retournent à la nature ou partent habiter à la campagne. Souvent, il s'agit de personnes peu ou mal informées qui se rendent en forêt pour des raisons diverses telles que se promener, faire de la course d’orientation, herboriser, ramasser des champignons ou camper. Fréquemment leurs vêtements ne sont pas adaptés à leur activité, la mode actuelle réduit d'ailleurs beaucoup l'effet protecteur des vêtements contre les morsures et les piqûres d'arthropodes hématophages. De plus, l’accès à la forêt est maintenant facilité par une politique d’ouverture au public précisée par la circulaire de l’ONF du 26 février 1979.

Avec l'automobile, l'habitat s'est disséminé, les villes
qui s'agrandissaient naguère de proche en proche, s'étendent
maintenant de façon excentrique dans les vallées en excluant
les pentes trop fortes. Ce qui conduit à la création d'espaces
péri-urbain ou s'imbriquent zones urbaines et rurales. Petit à
petit, les enclaves de terres vouées à l'abandon ont été
recolonisées par la faune et la végétation. Dermacentor
reticulatus s'est parfaitement adapté à ce nouvel habitat
et aux landes suburbaines, on le retrouve systématiquement dès
que les surfaces dépassent un hectare [201, 202].
Les animaux sauvages ne sont pas absents des villes. Les oiseaux sont
plus nombreux et plus visibles que les mammifères aux mœurs
plus nocturnes. Si le moineau était déjà décrit
comme un fléau en ville au XVIIIe siècle, le
merle et le pigeon n'y sont apparus que depuis un siècle, suivis
par la grive musicienne, puis par la tourterelle turque dans les années
1960. Une  cinquantaine
d'espèces d'oiseaux s'est totalement adaptée à l'environnement
urbain, principalement des passereaux, sédentaires, migrateurs
ou sédentarisés. Les mammifères vivent davantage
en périphérie des villes, ils sont présents dans
les bois et les parcs. Les petits rongeurs (souris, surmulot, rat, campagnol
roussâtre), écureuils, lapins, hérissons, les petits
carnivores mustélidés et les chauves-souris se sont parfaitement
accomodés à ce nouveau mode de vie. Le renard commence aussi
à apparaître.
cinquantaine
d'espèces d'oiseaux s'est totalement adaptée à l'environnement
urbain, principalement des passereaux, sédentaires, migrateurs
ou sédentarisés. Les mammifères vivent davantage
en périphérie des villes, ils sont présents dans
les bois et les parcs. Les petits rongeurs (souris, surmulot, rat, campagnol
roussâtre), écureuils, lapins, hérissons, les petits
carnivores mustélidés et les chauves-souris se sont parfaitement
accomodés à ce nouveau mode de vie. Le renard commence aussi
à apparaître.
Différents animaux sont donc susceptibles d'importer des tiques
en ville, et d'y entretenir leur cycle de vie. Cette hypothèse
est confortée par un certain nombre d'observations, même
en France ; des cas de piroplasmose canine y sont notamment observés,
touchant des animaux vivant exclusivement en ville ( D.
reticulatus); des morsures de tiques sont constatées chez
des personnes fréquentant les jardins publics ( I.
ricinus). Ixodes
hexagonus et I. trianguliceps
sont collectés sur les petits mammifères. Enfin, des
morsures d'Argasidés occasionnent régulièrement des
réactions anaphylactiques parmi les habitants des étages
supérieurs de l'habitat ancien (Ixodes
uriæ et Ornithodoros
maritimus).
La France est un des pays où les animaux de compagnie sont les plus nombreux. Les chiens notamment, représentent un risque épidémiologique important car ils attrapent très facilement des dizaines, voire des centaines de tiques à l’occasion de leurs sorties en nature.
Depuis 1974, l'augmentation du coût de l'énergie
a provoqué le doublement des affouagistes, un foyer sur deux en
France utilise du bois de chauffage, au moins occasionnellement. La paupérisation
amène aussi à la forêt, des chômeurs et des
RMIstes, souvent fragilisés par des conditions de vie précaires,
attirés par l’argent que pourra leur apporter la cueillette des
champignons. On les rencontre du printemps jusqu’à l’automne, précisément
pendant la période d’activité des tiques.
La transmission d’une maladie vectorielle met en jeu un vecteur, un agent pathogène et souvent plusieurs hôtes vertébrés. Pour être efficace, elle suppose donc la réalisation de nombreuses conditions :
- la présence de l’agent pathogène chez un hôte vertébré,
- un arthropode hématophage ayant un contact étroit avec ce vertébré,
- une adaptation de l’agent pathogène à l’arthropode, lui permettant de s’y développer et d’être retransmis à un autre hôte vertébré.
La création de tels systèmes suppose une très longue co-évolution de l’ensemble des intervenants et des facultés très importantes d’adaptation du vecteur vers l’hôte, et de l’agent pathogène avec le vecteur.
Dernière mise à jour : le 16 02 2006
Remerciements à Cl. Pérez-Eid


