| Be
notified of page updates |
| powered by ChangeDetection |
Les tiques sont des acariens dont on connaît 869 espèces et sous-espèces valides dans le Monde, réparties en trois familles [806], ou 889 espèces selon Ticksbase version 5.6, juin 2005 (www.icttd.nl).
- Les tiques dures, ou Ixodidæ, représentent environ 670 espèces connues ; elles possèdent des zones de tégument chitinisé dur.
- Les Argasidæ, environ 180 espèces, ont un tégument sans sclérification qui leur vaut le nom de "tiques molles".
- Un seul représentant des Nuttalliellidæ a été identifié, il appartient à une famille intermédiaire entre les deux précédentes.
Toutes les tiques sont hématophages, donc potentiellement vectrices
de maladies.
Mais quelques unes seulement ont une importance médicale, en raison
de la pathologie humaine ou vétérinaire qu’elles occasionnent.
Elles transmettent une trentaine d'agents pathogènes, tant virus, bactéries,
protozoaires que nématodes.
Cependant ce chiffre est susceptible d'être réévalué
à la hausse, car tous les agents pathogènes n'ont pas encore
été identifiés. Des intoxications à neurotoxines
(paralysie à tiques), ainsi que des allergies à la salive de
tiques sont également possibles.
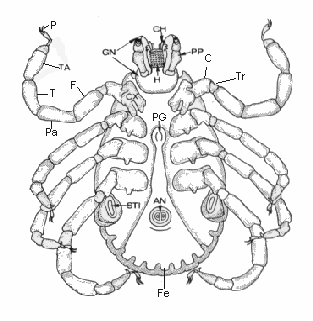 Les Ixodidés ont un corps non segmenté, formé de 2 parties.
À l'avant le gnathosome (GN) ou capitulum. À l'arrière
l'idiosome formé d'une cuticule souple et extensible permettant la
réplétion ; sur la face dorsale se trouve une plaque, le scutum,
dont la taille est variable selon le sexe et les espèces. Les pattes
sont formées de 6 segments : coxa, trochanter-fémur, patelle,
tibia, tarse terminé par une ventouse (pulville) et 2 griffes (respectivement:
C, Tr et Fémur, Pa, T, TA, P, cliquer
pour agrandir le schéma). Illustration tirée de Ticks.
Les Ixodidés ont un corps non segmenté, formé de 2 parties.
À l'avant le gnathosome (GN) ou capitulum. À l'arrière
l'idiosome formé d'une cuticule souple et extensible permettant la
réplétion ; sur la face dorsale se trouve une plaque, le scutum,
dont la taille est variable selon le sexe et les espèces. Les pattes
sont formées de 6 segments : coxa, trochanter-fémur, patelle,
tibia, tarse terminé par une ventouse (pulville) et 2 griffes (respectivement:
C, Tr et Fémur, Pa, T, TA, P, cliquer
pour agrandir le schéma). Illustration tirée de Ticks.
 La
première paire de pattes porte l'organe de Haller (voir photo
http://www.zecken.de ci
contre). Cet organe sensoriel situé dans une dépression du tarse,
est sensible à la fois au degré d'hygrométrie, aux phéromones,
au gaz carbonique, aux métabolites exhalés par les ruminants,
à l'acide lactique...
La
première paire de pattes porte l'organe de Haller (voir photo
http://www.zecken.de ci
contre). Cet organe sensoriel situé dans une dépression du tarse,
est sensible à la fois au degré d'hygrométrie, aux phéromones,
au gaz carbonique, aux métabolites exhalés par les ruminants,
à l'acide lactique...
Il sert d'organe olfactif à la tique. Les poils sont sensibles aux
vibrations et aux variations de température.
 À
l'exception des larves qui en sont dépourvues, les tiques respirent
grâce à un système trachéolaire très ramifié
prolongé par de très fines trachéoles qui amènent
l'oxygène jusqu'au contact des organes.
À
l'exception des larves qui en sont dépourvues, les tiques respirent
grâce à un système trachéolaire très ramifié
prolongé par de très fines trachéoles qui amènent
l'oxygène jusqu'au contact des organes.
Les 2 troncs tachéolaires s'ouvrent sous forme de stigmates situés
en arrière des coxae 4. Ils sont entourés d'une plaque stigmatique,
de taille et de forme variables selon les espèces, constituée
d'une sorte de tamis garni de poils hydrophobiques qui ont la propriété
de retenir une mince épaisseur d'air (Schmidt-Nielsen 1997). Ce plastron
permet à la tique de survivre plusieurs jours en immersion totale.
Dans le cas de Dermacentor variabilis, cette survie peut se prolonger
jusqu'à 3 semaines [898]
 Les
pédipalpes eux aussi, ont un rôle sensoriel, ils possèdent
des chémorécepteurs. Les pièces buccales sont constituées
par les chélicères et l'hypostome. Les chélicères
servent à percer et dilacérer les tissus. Elles permettent ainsi
la pénétration de l'hypostome qui s'ancre solidement dans les
tissus grâce à ses dents placées sur la face ventrale.
(image http://res2.agr.ca/ecorc/ti/extern-structures_images_e.htm#fig_02d.gif)
Les
pédipalpes eux aussi, ont un rôle sensoriel, ils possèdent
des chémorécepteurs. Les pièces buccales sont constituées
par les chélicères et l'hypostome. Les chélicères
servent à percer et dilacérer les tissus. Elles permettent ainsi
la pénétration de l'hypostome qui s'ancre solidement dans les
tissus grâce à ses dents placées sur la face ventrale.
(image http://res2.agr.ca/ecorc/ti/extern-structures_images_e.htm#fig_02d.gif)


L'identification des Ixodidés s'établit à partir
de l'étude de structures morphologiques (de préférence
chitinisées, car indéformables après engorgement). Elle
est largement orientée par la connaissance de l'hôte d'accueil
et la provenance.
Pour y pavenir, il est nécessaire de disposer d'une loupe binoculaire
au grossissement de 60 fois minimum, munie d'un bon éclairage épiscopique.
Cette tâche, loin d'être évidente pour les tiques adultes,
devient particulièrement complexe pour les stases pré-imaginales,
même si l'on est muni des clés d'identification !
![]() Aide
à l'identification en ligne:
Aide
à l'identification en ligne:
- site de systématique de M. Becker (en allemand)
- Identification Key homepage (en anglais)
- Guides actualisés de détermination des tiques de l’ICTTD-2 et 3
- CD Rom du Armed Force Pest Management Board
- Fauna of Ixodids of the World de GV Kolonin
- Dartmoor Tick Watch
- Arachnida identification guide & checklist
De nouvelles techniques moléculaires offrent maintenant la possibilité d'identifier les différentes espèces eurasiennes de tiques d'importance médicale, quel que soit leur stase: Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus, Ixodes hexagonus, Dermacentor reticulatus [939]. Ces techniques demeurent du domaine de la recherche.

Pour des informations plus complètes, en rapport avec les tiques de
France métropolitaine, on se rapportera à :
Les tiques.
Identification, biologie, importance médicale et vétérinaire
de Claudine Pérez-Eid [447].
![]()
Le cycle évolutif des Ixodidæ se déroule en trois
stases:
![]() De
l’œuf naît une larve hexapode, inframillimétrique, à peine
perceptible à l’œil nu.
De
l’œuf naît une larve hexapode, inframillimétrique, à peine
perceptible à l’œil nu.
Après s’être fixée pendant quelques jours sur un vertébré
pour se gorger lentement de sang, elle se laisse tomber sur le sol, pour digérer
et muer...
![]() En
une nymphe octopode mesurant environ un millimètre à jeun. Le
deuxième repas de sang est pris dans les mêmes conditions de
durée. La nymphe repue mesure alors 2mm, elle se détache et
tombe au sol pour muer ...
En
une nymphe octopode mesurant environ un millimètre à jeun. Le
deuxième repas de sang est pris dans les mêmes conditions de
durée. La nymphe repue mesure alors 2mm, elle se détache et
tombe au sol pour muer ...
![]() En
une tique adulte de 3 à 4 mm. La femelle, après copulation,
devra une dernière fois se gorger pleinement de sang, jusqu’à
prendre la taille d’un petit pois. Ce repas lui permettra de pondre de 1 000
à 20 000 œufs, selon l'espèce et le sang ingéré,
avant de se dessécher et de mourir.
En
une tique adulte de 3 à 4 mm. La femelle, après copulation,
devra une dernière fois se gorger pleinement de sang, jusqu’à
prendre la taille d’un petit pois. Ce repas lui permettra de pondre de 1 000
à 20 000 œufs, selon l'espèce et le sang ingéré,
avant de se dessécher et de mourir.

Malgré le nombre d'oeufs pondus, la densité
de ces acariens reste relativement stable d'une année sur l'autre.
Le taux de survie demeure en effet très modeste, en raison des conditions
climatiques et des prédateurs.
 Par
exemple pour I. ricinus, après l'éclosion des 2 à
3000 oeufs, maximum, 5% des larves survivent, et seulement 10 % d'entre-elles
parviennent à la stase nymphale. Vingt pour cent d'entre-elles parviendront
à la stase adulte.
Par
exemple pour I. ricinus, après l'éclosion des 2 à
3000 oeufs, maximum, 5% des larves survivent, et seulement 10 % d'entre-elles
parviennent à la stase nymphale. Vingt pour cent d'entre-elles parviendront
à la stase adulte.
Il faut donc environ 2000 oeufs pour obtenir un couple reproducteur et maintenir
l'équilibre [293].
Le mâle ne s'alimente pas, ou rarement et très peu.
La durée d’un cycle est en moyenne de 2 à 4 ans, pouvant aller
à 7 ans si les conditions climatiques ne sont pas favorables.
![]()
Les préférences écologiques des tiques sont variables
: certaines espèces vivent en milieu ouvert, d'autres en milieu abrité.
Les premières sont dites exophiles, les secondes endophiles (ou pholéophiles).
Une même espèce peut également occuper successivement
les 2 habitats, en fonction des périodes de son cycle biologique. La
densité des tiques est liée aux associations végétales,
à l'hygrométrie, au cycle des saisons, autant qu'à la
diversité des hôtes. Elle est donc étroitement liée
au climat, qui influence à la fois la végétation, la
température et l'hygrométrie.
La distribution spatiale des tiques est aussi régie par le maximum
de probabilités de rencontre avec l'hôte, c'est à dire
zones de nourrissage, zones de repos ou le long des coulées des animaux.
Les tiques exploitent leur temps de fixation sur l'hôte pour se déplacer
passivement, cependant en l'absence d'hôte, même les larves sont
capables de se déplacer sur de courtes distances [845].
Ce comportement semble assez fréquent chez I. ricinus quand
il fait chaud ; il est maintenant bien connu chez R. sanguineus qui
adopte une stratégie d'attaque et élargit sa sélectivité
lorsque la température s'élève au delà de 30°C.

Cependant, à la différence des autres arthropodes hématophages,
tels que les moustiques, les tiques ne disposent pas de moyens importants
de déplacement. Les tiques exophiles sont majoritairement des tiques
dures. Elles passent des mois à survivre au sol, attendant de rencontrer
un hôte à leur convenance pour effectuer 2 à 3 repas qui
ne dureront au maximum en tout qu'une vingtaine de jours.
Ces repas constituent leur unique source d'énergie pour les mues et
le temps en attente d'hôtes. Très sensibles à la dessiccation
les tiques doivent redescendre régulièrement au sol pour se
réhydrater.
Leur durée de quête décroît donc avec le pouvoir
desséchant de l'air.
Par contre, leur période de repos au sol est indépendante de
ce facteur.
Plus il fait sec plus les tiques se déplacent, toutefois leurs déplacements
sont maximaux la nuit, alors que l'hygrométrie est plus élevée
et le risque de dessiccation minoré [846].
Le choix des sites de quête est régi par la présence d'hôtes.
La nuit la tique perçoit mieux les traces odorantes déposées
fraîchement par ses hôtes potentiels sur les herbes, elle se poste
alors dans leurs traces, là où ils risquent le plus de repasser.
Les tiques ont développé une stratégie de détection
de l'hôte à distance qui revêt la plus grande importance.
Dès qu'elles perçoivent la proximité d'un hôte,
elles s'activent au sommet de leur brindille [280]. La rencontre
avec l’hôte est conditionnée par sa densité de population,
aussi bien que par la dimension du biotope.
Les tiques ne provoquent donc que rarement de réelles épidémies,
comme en 1975 dans le comté de Lyme; mais leur pullulation associée
aux changements du mode de vie sont à l’origine de cas d’infections
sporadiques de plus en plus fréquents.
 L’activité
d'I. ricinus est conditionnée par les heures chaudes de la journée,
par des températures comprises entre 7 et 25°C. Cette espèce
est quasiment inactive pour les températures inférieures et
entredans une sorte de diapose lorsque la chaleur est intense et l'hygrométrie
basse. De ce fait, dans le quart nord-est de la France, son activité
s'étend de mai à octobre, avec une accalmie en juillet-août.
L’activité
d'I. ricinus est conditionnée par les heures chaudes de la journée,
par des températures comprises entre 7 et 25°C. Cette espèce
est quasiment inactive pour les températures inférieures et
entredans une sorte de diapose lorsque la chaleur est intense et l'hygrométrie
basse. De ce fait, dans le quart nord-est de la France, son activité
s'étend de mai à octobre, avec une accalmie en juillet-août.
Une activité unimodale est rencontrée dans les zones où
les conditions climatiques sont moins favorables. Le risque de contracter
une maladie de Lyme en Alsace, ou en Lorraine, est de toute façon très
limité de janvier à février.
Une activité bimodale est observée dans les zones où
les températures cumulées de mars à juillet sont suffisantes
pour autoriser une mue rapide permettant à la tique de reprendre une
quête automnale.

 Pour
se nourrir, quelle que soit sa stase, I. ricinus pratique l’affût
(exophile) : les larves se postent au sommet d'herbes basses, où l'hygrométrie
est la plus importante ; les adultes plus résistants montent quelquefois
jusqu'à 1,50 mètre, sur des herbes, des ronces ou des fougères
(voir schéma ci-contre). Installées à leur poste,
les tiques tendent leurs 2 deux pattes antérieures dès qu'elles
perçoivent l'arrivée d'un hôte potentiel puis agrippent
sa fourrure, les vêtements ou la peau s'il s'agit d'un humain. Le réflexe
d’accrochage paraît stimulé par le mouvement, la chaleur ou l’émission
de dioxyde de carbone.
Pour
se nourrir, quelle que soit sa stase, I. ricinus pratique l’affût
(exophile) : les larves se postent au sommet d'herbes basses, où l'hygrométrie
est la plus importante ; les adultes plus résistants montent quelquefois
jusqu'à 1,50 mètre, sur des herbes, des ronces ou des fougères
(voir schéma ci-contre). Installées à leur poste,
les tiques tendent leurs 2 deux pattes antérieures dès qu'elles
perçoivent l'arrivée d'un hôte potentiel puis agrippent
sa fourrure, les vêtements ou la peau s'il s'agit d'un humain. Le réflexe
d’accrochage paraît stimulé par le mouvement, la chaleur ou l’émission
de dioxyde de carbone.
I. ricinus est dépourvu d'yeux, mais il possède des photorécepteurs
qui lui permettent d'évaluer la luminosité. Son activité
se poursuit dans l'obscurité, alors que l'hygrométrie s'accroît
; cette particularité lui permet de parasiter les hôtes vertébrés
aux moeurs nocturnes [256].
Certaines espèces de tiques sont pourvues d'yeux qui leur permettent
de se diriger à vue vers leurs hôtes. C'est notamment le cas
des Hyalomma spp. qui sont capables d'identifier un chameau et de se
diriger vers lui ; le fait a été démontré expérimentalement
les tiques se diririgent très sûrement vers les images qui représentent
leur hôte de prédilection.
Les
hôtes des tiques [304]
Certaines espèces d'Ixodidae, dites monotropes, se
gorgent sur une seule espèce, ou une seule famille, de rongeurs, de
bovidés ou de carnivores. Rhipicephalus sanguineus qui choisit
le chien à ses 3 stases en est un excellent exemple.
Les larves et nymphes de Dermacentor reticulatus ont un tropisme
marqué pour les micro-mammifères myomorphes, alors que l’adulte
se fixe sur des hôtes de grande taille comme les chiens, les cervidés,
les suidés ou occasionnellement sur l’homme ; il est l'exemple type
de la tique ditrope.
Ixodes ricinus lui, n’a pas de tropisme marqué aux stases larvaire
et nymphale (larves et nymphes ubiquistes), mais il marque une nette préférence
pour les mammifères de grande taille (sélectivité plus
restreinte) à la stase adulte, il est dit télotrope.

Effets du changement climatique sur les tiques et les maladies
à tiques en Europe [775].
L'augmentation d'incidence des maladies à tiques en Europe semble
être favorisée en partie par le changement climatique. La densité
des tiques n'est pas seule responsable car on observe que les pics de densité
des tiques sont décalés des pics de morsures, même lorqu'il
y a peu de tiques. Le comportement humain est très certainement en
partie responsable, car on observe que les morsures résultent en fait
de périodes de fréquentation humaine plus intense du milieu
naturel.
Les données concernant I. ricinus, les Dermacentor sp.
et Rh. sanguineus montrent que l'aire de répartition de
ces vecteurs progresse vers le nord et les altitudes plus élevées
où les températures sont plus clémentes et l'hygrométrie
plus favorable..
Les hivers plus cléments expliquent probablement aussi l'élargissement
de la période d'activité d'I. ricinus, au point que la
tique peut pratiquement être collectée durant tout l'hiver; le
fait est établi par Dautel et al. autour de Berlin [776].
Outre l'augmentation de l'activité vextorielle, les projections d'avenir
en fonction d'un réchauffement climatique font redouter la naturalisation
possible au sud de l'Europe de 8 espèces de tiques d'importance
médico-vétérinaire et des agents pathogènes qui
leurs sont associés : Boophilus, Dermacentor, Hyalomma, Rhipicephalus.
Voir Hyalomma marginatum
et la Fièvre de Congo-Crimée
 Facteurs
environnementaux de variation de l’abondance des tiques Ixodes ricinus
dans des zones d’étude modèles en Auvergne. Thèse
de doctorat d'université de Chloé Boyard [503].
Facteurs
environnementaux de variation de l’abondance des tiques Ixodes ricinus
dans des zones d’étude modèles en Auvergne. Thèse
de doctorat d'université de Chloé Boyard [503].
Effects
of climate change on ticks and tick-borne diseases in europe. Gray JS
et al.[775].
The
Sensory Physiology of the Sheep Tick, Ixodes Ricinus L. Lees AD. [847].
 Contrairement
aux autres arthropodes hématophages, les ixodidés ont la particularité
de se gorger très lentement.
Contrairement
aux autres arthropodes hématophages, les ixodidés ont la particularité
de se gorger très lentement.
Après s'être agrippée à la fourrure d'un animal
passant à sa proximité, la tique se déplace sur son hôte
jusqu'à trouver une zone richement vascularisée. Elle doit alors
s'y ancrer solidement pendant plusieurs jours à l'aide de son hypostome,
afin d'avoir suffisamment de temps pour parvenir à se gorger complètement.
Pour éviter toute réaction de défense de l'hôte,
qui pourrait compromettre la fixation par un toilettage trop vigoureux, la
tique s'est adaptée afin de passer la plus inaperçue possible
[274]. Elle se fixe en un endroit discret et opère de façon
indolore.
Ses chélicères sont capables de découper l'épiderme
sans provoquer la moindre douleur. Sa salive, digère progressivement
les tissus de l'hôte, et ouvre graduellement la voie à la pénétration
de l'hypostome dans la peau, sans éveiller l'attention de l'hôte.
La tique provoque ensuite la formation d'une cavité dermique qui se
remplit de sang et d'exsudats tissulaires, qu'il ne lui reste plus qu'à
aspirer au travers de son hypostome.
La durée du gorgement varie, selon les espèces et les stases.
Habituellement, une première phase lente d'environ 1 semaine permet
à la tique de décupler son poids ; elle est suivie d'une seconde
phase rapide, de 12 à 24 heures, où la tique le décuple
encore. Le volume de sang ingéré en réalité n'est
pas de 100, mais de 200 à 300 fois son poids. Les glandes salivaires
de la tique  ont
en effet la capacité de concentrer ses ingesta avant de réinjecter
l'excédent de fluides à l'hôte. Pendant toute la durée
du gorgement, elles produisent une quantité importante de salive qui
permet non seulement d'éliminer l'excès d'eau, mais aussi d'équilibrer
la balance ionique.
ont
en effet la capacité de concentrer ses ingesta avant de réinjecter
l'excédent de fluides à l'hôte. Pendant toute la durée
du gorgement, elles produisent une quantité importante de salive qui
permet non seulement d'éliminer l'excès d'eau, mais aussi d'équilibrer
la balance ionique.
Ces glandes salivaires sont dotées de 3 types d'acini possédant
chacun des fonctions propres : production de cément et de diverses
substances… Elles sont aussi le siège de différents agents
pathogènes et de toxines susceptibles d'être injectés
à l'hôte [275]…
 Toute
effraction de la barrière cutanée, morsure, ou piqûre,
provoque normalement la miseen œuvre des facteurs de l'hémostase
: vasoconstriction et coagulation. Ce phénomène peut être
accompagné de réactions inflammatoires ou d'hypersensibilité.
Toute
effraction de la barrière cutanée, morsure, ou piqûre,
provoque normalement la miseen œuvre des facteurs de l'hémostase
: vasoconstriction et coagulation. Ce phénomène peut être
accompagné de réactions inflammatoires ou d'hypersensibilité.
Les macrophages convergent vers le site de ponction, pour phagocyter les débris
et les bactéries ; les basophiles pour libérer de l'histamine
et de la sérotonine ; il s'en suit une inflammation et une éruption
autour du site de ponction. La fixation de la tique ne pourrait donc pas se
prolonger sans déjouer efficacement les mécanismes de protection
de l'hôte (toilettage, hémostase et immunité). D'autant
moins que sa salive contient de nombreuses substances protéiques (SGE),
susceptibles de déclencher des réactions antigéniques.
Toute ingestion de basophiles, ou d'une des armes chimiques
qu'ils émettent par dégranulation,  se
solderait irrémédiablement par la destruction du tube digestif
puis de la tique. D'ailleurs, en cas d'immunité acquise de l'hôte,
la tique ne dispose d'aucun moyen pour rester fixée ; le gorgement
est perturbé et la tique doit se laisser tomber prématurément.
se
solderait irrémédiablement par la destruction du tube digestif
puis de la tique. D'ailleurs, en cas d'immunité acquise de l'hôte,
la tique ne dispose d'aucun moyen pour rester fixée ; le gorgement
est perturbé et la tique doit se laisser tomber prématurément.
Une faille dans la stratégie de la tique, qui ouvre la voie à
une immunité artificiellement induite par vaccination. Cette technique
est déjà utilisée avec succès en médecine
vétérinaire, pour protéger les troupeaux bovins australiens.
Différentes
voies d'immunité impliquées dans les interactions
complexes tiques-vertébrés-micropathogènes
(K.McCoy, V. Staszewsky)
Pour contourner les défenses de l'hôte, la salive de la tique
contient des substances qui contrecarrent l'hémostase (anticoagulants
Ixodes ricinus contact phase
inhibitor (Ir-CPI), [795] et prostaglandines vasodilatatrices),
de puissants antihistaminiques inhibent la dégranulation des basophiles.
Cette salive contient également des substances qui limitent l'adhésion
et la fonction inflammatoire des polynucléaires neutrophiles, l'Ir-LBP
bloque la LTB4 et altère l'efficacité des neutrophiles [796],
favorisant ainsi la transmission
d'agents pathogènes qui pourraient avoir été injectés
[276, 314, 322]. Par exemple, Borrelia burgdorferi exploite
la protéine salivaire Salp 15 d' I. scapularis pour infecter
la souris [337]. La protéine salivaire IRIS (pour Ixodes
ricinus immuno- suppressor)
diminue la réponse cellulaire de l'hôte.
![]() De
possibles applications thérapeutiques à venir ?
De
possibles applications thérapeutiques à venir ?
Les propriétés pharmacologiques de la salive de tique sont
particulièrement nombreuses et variées, certaines pourraient
bientôt trouver des applications thérapeutiques chez l'homme
dans le domaine de l'allergie, de la coagulation et du cancer.
![]() Ainsi
l'Ixodes ricinus contact phase inhibitor (Ir-CPI), une protéine
de type Kunitz exprimée par les glandes salivaires de la tique, pourrait
bientôt être exploitée pour ses propriétés
antithrombotiques [628,795].
Ainsi
l'Ixodes ricinus contact phase inhibitor (Ir-CPI), une protéine
de type Kunitz exprimée par les glandes salivaires de la tique, pourrait
bientôt être exploitée pour ses propriétés
antithrombotiques [628,795].
![]() Selon
AM Chudzinski-Tavassi (Institut Butantan de Sao Paulo), certaines substances
contenues dans la salive de Amblyomma cajennense possèderaient
des propriétés anticancéreuses. Il s'agit d'une protéine
anticoagulante appelée Facteur X active proche du TFPI (Tissue Factor
Pathway Inhibitor), qui aurait la capacité de réduire, voire
de détruire certaines tumeurs. Cette découverte prometteuse
publiée par l'AFP le 28 septembre 2009 devra être confirmée
par des années de recherche [860].
Selon
AM Chudzinski-Tavassi (Institut Butantan de Sao Paulo), certaines substances
contenues dans la salive de Amblyomma cajennense possèderaient
des propriétés anticancéreuses. Il s'agit d'une protéine
anticoagulante appelée Facteur X active proche du TFPI (Tissue Factor
Pathway Inhibitor), qui aurait la capacité de réduire, voire
de détruire certaines tumeurs. Cette découverte prometteuse
publiée par l'AFP le 28 septembre 2009 devra être confirmée
par des années de recherche [860].
![]()
Quarante et une espèces de tiques ont été signalées
en France continentale et en Corse [333, 809]. Onze espèces
seulement sont impliquées dans le parasitisme humain [809].
Quatre Ixodidés (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus,
D. marginatus et Rhipicephalus sanguineus) sont à l’origine
de la plupart des pathologies les plus fréquentes et les plus importantes.
Ixodes ricinus joue un rôle majeur en pathologie humaine.
Dans l'est de la France plusieurs espèces exophiles pouvent se fixer
sur l’homme : Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus,
D. marginatus, peut-être aussi Hæmaphysalis
concinna et H.
punctata.
Par son adaptation au milieu urbain, I. hexagonus représente
une possible menace pour la Santé publique.
Ixodes ricinus
est l’espèce de loin la plus répandue en France, il est capable
de se nourrir tant sur les reptiles que sur les oiseaux ou les mammifères.
Il accepte plus de 300 espèces d'hôtes.
À ses trois stades évolutifs il est susceptible de s’attaquer
à l’homme. Très hygrophile, il vit dans les sous-bois humides;
sa présence est non seulement liée à des groupements
végétaux précis, mais aussi à celle des animaux
sauvages ou domestiques. Cet Ixodes est présent partout en France,
sauf à des altitudes excédant 1200 mètres, dans des régions
trop sèches ou inondables. Il ne peut cependant pas survivre sans une
constante humidité.
Son importation accidentelle à la maison, par un chien ou des vêtements
ne présente donc pas grand risque de transmission pour ses occupants
; très rapidement, si l'hygrométrie est inférieure à
70%, il va se dessécher et mourir.
En Lorraine I. ricinus joue un rôle de premier plan dans les
maladies transmises par les tiques. Il est notamment vecteur d'Anaplasma
phagocytophilum, de Bartonella henselae, d'au moins quatre génotypes
pathogènes de Borrelia, de Rickettsia helvetica, de Babesia,
des virus TBEV-CEE, Eyach.


Dermacentor reticulatus
est également une espèce exophile à certaines stases.
L'adulte pratique l’affût sur la végétation, mais davantage
en milieu ouvert qu’I. ricinus, car il préfère les prairies
et les bosquets, aux forêts où il se limite plutôt à
la lisière des chemins et aux clairières.
Sa présence est retrouvée aussi en zone rurbaine (péri-urbaine)
et suburbaine, notamment dans les terrains vagues. Sa densité de population
est très inégale sur le territoire français, mais il
semble présent partout. D. reticulatus reste actif presque toute
l’année, bien qu'il ne puisse pas être collecté par des
températures inférieures à 0°C. Il marque une véritable
diapause en été. Cette tique est le vecteur principal de Francisella
tularensis (Mollaret), le vecteur secondaire du virus de l’encéphalite
TBE (sous-type CEE), peut-être de Borrelia et de Rickettsia
et du virus Erve (ERV).


Dermacentor marginatus
est une espèce très voisine de D. reticulatus, tant sur
le plan de la morphologie que sur celui de agents pathogènes qu'elle
transmet. Elle est retrouvée un peu plus au sud, notamment dans les
pays qui bordent la Méditerrannée. L'espèce est toutefois
régulièrement collectée en Lorraine par l'auteur, elle
est présente jusqu'à 2 500 mètres d'altitude [608].


Rhipicephalus sanguineus
est abondant dans le midi méditerranéen et le sud-ouest de la
France. Il peut aussi être importé au nord de la Loire dans les
bagages, ou par un chien, et survivre en extérieur à la belle
saison. Son adaptation parfaite à la sécheresse lui permet les
invasions domiciliaires, des cas ont été décrits non
seulement en France septentrionale, mais en Belgique, en Angleterre, en Suisse
et au Danemark. Tique endophile, xérophile et inféodée
au chien, Rhipicephalus sanguineus adulte, sa larve, ou sa nymphe,
peuvent aussi s’attaquer aux habitants de la maison avec les risques infectieux
habituels [8]. Il est vecteur et réservoir de diverses Rickettsia
sp. du complexe de R. conorii, occasionellement il a la capacité
de transmettre le WNV ou différentes espèces de Leishmania
y compris dans le sud de la France [832].


Pholeoixodes hexagonus
est une tique endophile présente dans toute l'Europe occidentale, en
plaine comme en montagne, jusqu'à des altitudes de 1380 m. C'est l'espèce
la plus abondante en Europe après I. ricinus. Ses stases pré-imaginales
restent actives toute l'année. Cette tique, parasite du hérisson,
du renard et des Mustellidés, se fixe fréquemment sur les chiens
et les chats domestiques. Elle a la capacité de transmettre B. burgdorferi
aux vertébrés et de maintenir l'infection au sein d'une
population de tiques par transmission transstadiale et transovarienne. Elle
joue ainsi un rôle important dans l'écologie de la borréliose
de Lyme en assurant la circulation de B. burgdorferi, dans les
zones où I. ricinus est absent et pendant les périodes
où il est inactif.
I. hexagonus a également la capacité de transmettre le
virus de la méningoencéphalite à tiques, peut-être
aussi Theileria annae (Camacho et al, 2003) et C. burnetii
(Sixl et al, 1989) [391].
Il s'adapte particulièrement bien à la ville, comme son hôte
principal, le hérisson.
Cette espèce se fixe volontiers à l'homme, s'il pénètre
dans son habitat. Le risque "de rencontre" est relativement faible,
mais il a été décrit comme un fléau durant les
bombardements de Londres, lorsque la population devait régulièrement
descendre aux abris (Browning, 1944) [392].

Dernière mise à jour : le 14 10 2010
Remerciements à Cl. Pérez-Eid et M. Becker


