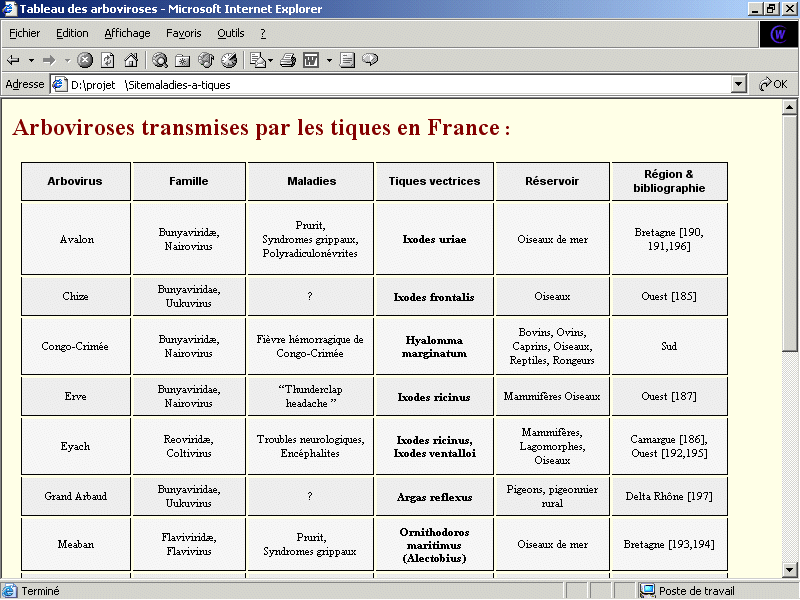| Be
notified of page updates |
| powered by ChangeDetection |
Les Argasidés sont des acariens présents partout
dans le Monde, avec une nette prédilection pour les régions
les plus chaudes du globe. Par le nombre, ils représentent la seconde
des trois grandes familles de tiques. Elle compte environ 180 espèces,
réparties en 3 genres principaux : Argas, Otobius et
Ornithodoros.
Ces tiques ont un tégument dépourvu de sclérification
qui leur vaut le nom de "tiques molles". Leur dimorphisme sexuel
est nettement moins marqué que chez les Ixodidés. Comme toutes
les tiques, elles sont exclusivement hématophages et donc potentiellement
vectrices d'agents
pathogènes. Selon les espèces, elles peuvent transmettre
des virus, des bactéries, des protozoaires ou des nématodes.
Leur salive allergisante est aussi fréquemment à l'origine de
réactions allergiques chez l'hôte.
 Les
Argasidés ont l'allure générale des acariens : leur corps
a une forme ovale, il est composé de 2 régions : le capitulum
et l'idiosome.
Les
Argasidés ont l'allure générale des acariens : leur corps
a une forme ovale, il est composé de 2 régions : le capitulum
et l'idiosome.
Leur tégument chitinisé est dépourvu de scutum, ce qui
leur vaut le nom de " tiques molles ".
Selon les espèces, la taille des adultes peut atteindre de 10 à
20 mm.
Les adultes vus de dessus montrent un idiosome de forme ovale aplatie. Ce
corps coriace et ridé n'est pas prolongé, comme chez les Ixodidés,
par des pièces buccales. Le capitulum est en effet caché à
la face ventrale, dans le camérostome.
Photos d'Argas reflexus B.
Pesson.
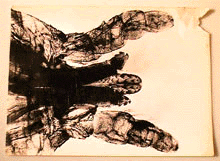 Seules
les larves (hexapodes) ont un capitulum nettement séparé de
l'idiosome, en position terminale. Elles possèdent également
des pulvilles au niveau du dernier article tarsal, alors que les autres stases
en sont dépourvues. Comme pour toutes les autres tiques, l'identification
des argasidés est largement orientée par la connaissance de
l'hôte d'accueil et la provenance. Par contre, elle s'avère particulièrement
difficile et relève exclusivement des spécialistes.
Seules
les larves (hexapodes) ont un capitulum nettement séparé de
l'idiosome, en position terminale. Elles possèdent également
des pulvilles au niveau du dernier article tarsal, alors que les autres stases
en sont dépourvues. Comme pour toutes les autres tiques, l'identification
des argasidés est largement orientée par la connaissance de
l'hôte d'accueil et la provenance. Par contre, elle s'avère particulièrement
difficile et relève exclusivement des spécialistes.
![]() Aide
à l'identification en ligne:
Aide
à l'identification en ligne:
- site de systématique de M. Becker (en allemand)
- Identification Key homepage (en anglais)
- Guides actualisés de détermination des tiques de l’ICTTD-2 et 3
- CD Rom du Armed Force Pest Management Board
- Fauna of Ixodids of the World de GV Kolonin
- Dartmoor Tick Watch
- Arachnida identification guide & checklist

Pour des informations plus complètes, en rapport avec les tiques de
France métropolitaine, on se rapportera à :
Les tiques.
Identification, biologie, importance médicale et vétérinaire
de Claudine Pérez-Eid [447].
Les Argasidæ possèdent un cycle de développement
en trois stases, larvaire, nymphale et adulte. Pour se gorger, les argasidés
ne se fixent qu'une trentaine de minutes, avant de se laissent tomber au sol
et se dissimuler à nouveau dans le nid ou le terrier de leur hôte.
C'est à cet endroit que les femelles pondent de 20 à 150 gros
œufs dans les fissures et anfractuosités.
![]() Les larves hexapodes ont une allure rappelant celles des Ixodidés,
avec un capitulum antérieur et des pulvilles aux 6 pattes. La durée
de leur repas est de l'ordre de 2 à 10 jours, si l'on excepte quelques
espèces d'Ornithodoros qui ne se gorgent pas, ou seulement en
quelques heures. Après le repas la larve se détache et entre
en pupaison.
Les larves hexapodes ont une allure rappelant celles des Ixodidés,
avec un capitulum antérieur et des pulvilles aux 6 pattes. La durée
de leur repas est de l'ordre de 2 à 10 jours, si l'on excepte quelques
espèces d'Ornithodoros qui ne se gorgent pas, ou seulement en
quelques heures. Après le repas la larve se détache et entre
en pupaison.
![]() La
nymphose est constituée de 2 à 7 stades, habituellement 4 ou
5.
La
nymphose est constituée de 2 à 7 stades, habituellement 4 ou
5.
Les mâles, plus petits, requièrent un nombre moins important
de stades.
À l'exception du pore génital et d'une taille moindre, les nymphes
ont une morphologie comparable à celle de la femelle. Chaque stade
fait suite à une mue simple, correspondant à un bref repas de
sang suivi par une augmentation de taille.
![]() Les adultes
apparaissent lorsque la taille et les fonctions physiologiques sont compatibles.
Mâles et femelles effectuent de nombreux repas durant toute leur vie.
Les adultes
apparaissent lorsque la taille et les fonctions physiologiques sont compatibles.
Mâles et femelles effectuent de nombreux repas durant toute leur vie.
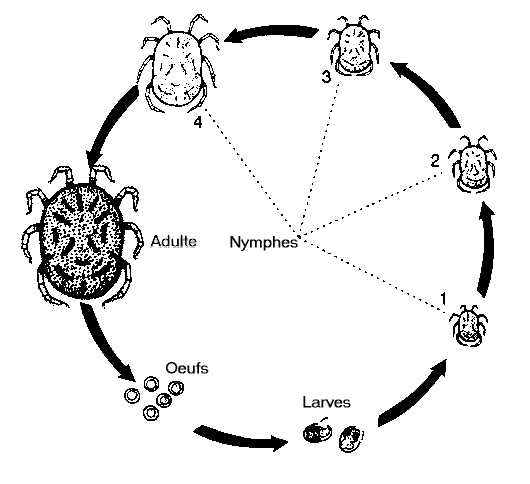
![]()
 Le
caractère principal des Argasidés est l'endophilie. Ces tiques
particulièrement sédentaires, sont généralement
monotropes. Elles restent généralement toute leur vie à
proximité immédiate de leur hôte, dans un nid d'oiseau,
un terrier de mammifère, une grotte, une fissure, une muraille, ou
sous l'écorce d'un arbre...
Le
caractère principal des Argasidés est l'endophilie. Ces tiques
particulièrement sédentaires, sont généralement
monotropes. Elles restent généralement toute leur vie à
proximité immédiate de leur hôte, dans un nid d'oiseau,
un terrier de mammifère, une grotte, une fissure, une muraille, ou
sous l'écorce d'un arbre...
Image http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1418023
 En
conséquence, de nombreuses générations se succèdent
généralement dans le même micro habitat.
En
conséquence, de nombreuses générations se succèdent
généralement dans le même micro habitat.
Dans ces conditions microclimatiques souvent très stables, les tiques
ne rencontrent habituellement pas de grosses difficultés à trouver
leur hôte. Comme les Ixodidés, elles sont guidées grâce
aux vibrations, à l'émission de CO2 et à la chaleur qu'elles
perçoivent, perçus par l'organe de Haller. Le plus souvent,
elles restent cachées le jour et piquent pendant la nuit (Argas
persicus, A. reflexus).
Les repas de sang sont habituellement toujours pris sur la même espèce
d'hôte, quel que soit le stade de développement des tiques.
La plupart des espèces d'Argasidés peuvent rester à jeun
de un à dix ans après le départ de leur hôte.
Elles sont dotées d'une très grande longévité.
Profitant de cette très grande stabilité, certains micro-organismes
ont pu longuement co-évoluer avec les Argasidés, notamment de
nombreuses espèces de Nairovirus et de Borrelia de fièvres
récurrentes. Fruits de cette longue co-évolution,  les
agents pathogènes sont très étroitement liés à
leur vecteur. Outre la grande diversité d'espèces de tiques,
il en résulte une différentiation géographique de souches
de microorganismes strictement adaptés à leur vecteur. L'exemple
le mieux connu est celui des Borrelia des fièvres récurrentes
à tiques dont une quinzaine d'espèces sont connues de par le
Monde.
les
agents pathogènes sont très étroitement liés à
leur vecteur. Outre la grande diversité d'espèces de tiques,
il en résulte une différentiation géographique de souches
de microorganismes strictement adaptés à leur vecteur. L'exemple
le mieux connu est celui des Borrelia des fièvres récurrentes
à tiques dont une quinzaine d'espèces sont connues de par le
Monde.
Quelques espèces d'argasidés sont susceptibles de se fixer sur
l'homme lorsque leur hôte de prédilection vient à manquer.
Les plus fréquemment rencontrées Argas monolakensis,
Ornithodoros coriaceus, O. erraticus et O. moubata.
Photo :
http://www.parassitologia.unina.it/PDF/zecche.pdf
 Le
cycle de développement des Argasidés nécessite un repas
de sang à chaque stase et à chaque stade. Pour Argas persicus
et A. reflexus la durée de ce repas varie en fonction du
stade de développement, la larve se fixe de 3 à 10 jours, alors
que les différentes stases de la nymphose se gorgent pendant 1 à
2 heures, Ornithodoros coriaceus peut avoir besoin de faire jusqu'à
7 repas nymphaux. Selon la température, les tiques atteindront la maturité
en 3 à 36 mois. Photo http://www.raptus.it/
images/image242.jpg
Le
cycle de développement des Argasidés nécessite un repas
de sang à chaque stase et à chaque stade. Pour Argas persicus
et A. reflexus la durée de ce repas varie en fonction du
stade de développement, la larve se fixe de 3 à 10 jours, alors
que les différentes stases de la nymphose se gorgent pendant 1 à
2 heures, Ornithodoros coriaceus peut avoir besoin de faire jusqu'à
7 repas nymphaux. Selon la température, les tiques atteindront la maturité
en 3 à 36 mois. Photo http://www.raptus.it/
images/image242.jpg
Durant toute leur vie, mâles et femelles effectuent de nombreux repas
qui ne durent pas généralement plus 15 à 20 minutes.
A. persicus peut prendre jusqu'à 7 repas, si besoin sur des
hôtes différents. Tous ces repas sont suivis chez la femelle
par la ponte de 20 à 150 gros œufs, dans les fissures et anfractuosités
de son habitat. Les accouplements ont lieu indifféremment avant ou
après les repas. A défaut de leur hôte de prédilection,
certaines espèces peuvent mordre l'Homme, il s'agit essentiellement
d'Argas et d'Ornithodoros.
 Les
Argasidés ne se gorgent pas de façon aussi spectaculaire que
les tiques dures, ils n'absorbent que 3 à 4 fois leur poids de sang
par repas. Ils sont, malgré tout, obligés d'éliminer
les excédents d'eau et de sels ingérés. Pour y parvenir,
ils disposent de moyens totalement différents de ceux mis en œuvre
par les Ixodidés.
Les
Argasidés ne se gorgent pas de façon aussi spectaculaire que
les tiques dures, ils n'absorbent que 3 à 4 fois leur poids de sang
par repas. Ils sont, malgré tout, obligés d'éliminer
les excédents d'eau et de sels ingérés. Pour y parvenir,
ils disposent de moyens totalement différents de ceux mis en œuvre
par les Ixodidés.

Les fluides sont éliminés en quantité importante par
les glandes coxales, que l'on peut facilement voir sourdre à la base
des coxa 1 et coxa 2. Ce mécanisme paraît particulièrement
adapté à la prise de repas rapides.
Selon les espèces, le processus est enclenché soit à
la fin de la phase de gorgement, soit aussitôt après avoir quitté
l'hôte. Ce qui revêt une très grande importance épidémiologique
dans la mesure où ce liquide coxal est potentiellement contaminant
pour l'hôte.
La salive n'intervenant pas, ou presque pas, pour éliminer les fluides
vers l'hôte, les Argasidés n'en injectent que très peu.
Leurs glandes salivaires étaient, naguère, supposées
être beaucoup moins complexes que celles des Ixodidés, et ne
compter que 2 types d'acini ; ce qui vient d'être récemment infirmé
par une étude sud-africaine [334]. La salive des argasidés
a la capacité de produire des substances lytiques, anesthésiques
et anticoagulantes, nécessaires au bon déroulement de la morsure
et du gorgement. Il semble la substance la plus fréquemment allergisante
serait une lipocaline (protéine destinée à empêcher
l'inflammation en bloquant l'histamine et la sérotonine).
Argas reflexus
[333]
est une espèce retrouvée partout en France, là où
vit au moins une cinquantaine de pigeons, que ce soit dans les pigeonniers,
les clochers ou les greniers des vieilles habitations, à la campagne
ou en ville.
Les A. reflexus colonisent les vieux murs où ils sont capables
de survivre des années après le départ des pigeons. Les
adultes peuvent tenir jusqu’à dix ans sans se nourrir, les nymphes
persistent pendant plus de 3 ans, et les larves jusqu'à 1 an.
Il s’agit d’une espèce monotrope, toutefois privée de son hôte
habituel, elle peut infester les humains vivant à proximité
immédiate comme le relate en détail le papier de H Benoît-Bazille
de 1909 [968].
A. reflexus occasionne des morsures douloureuses à l’origine
de réactions locales diverses (ecchymoses, prurit, allergies locales),
voire de chocs anaphylactiques.
Cette espèce s’est également révélée porteuse
de 7 arbovirus (notamment Grand Arbaud, et Pontevès en Camargue) et
de Rickettsiales qui n’ont pour l’instant pu être attachés à
aucune pathologie. Elle peut transmettre les virus du West Nile (WNV) et Chenuda.
Malgré de multiples enquêtes, son supposé rôle de
vecteur de Borrelia burgdorferi n'a jamais été établi.
Période d'activité verno-estivale.
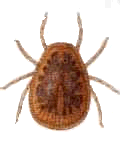
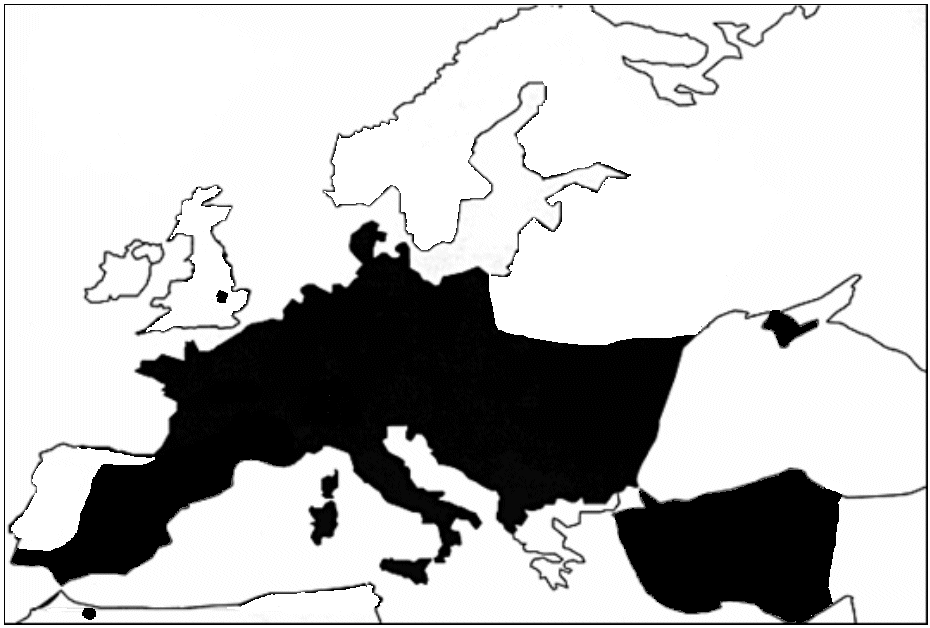
Argas persicus
 Est
une espèce voisine d'Argas reflexus,
c'est la tique de volailles, elle fréquente les poulaillers, mais pas
les pigeonniers. Cette espèce est rencontrée en Corse, elle
est vectrice de la spirochétose aviaire à Borrelia anserina
et de l’égyptianellose à Aegyptianella pullorum,
qui ne sont pas transmissibles à l'Homme. Elle a été
trouvée porteuse de bactéries identiques à Rickettsia
slovaca en Arménie en 1974 (Rehacek
et al, 1977).
Est
une espèce voisine d'Argas reflexus,
c'est la tique de volailles, elle fréquente les poulaillers, mais pas
les pigeonniers. Cette espèce est rencontrée en Corse, elle
est vectrice de la spirochétose aviaire à Borrelia anserina
et de l’égyptianellose à Aegyptianella pullorum,
qui ne sont pas transmissibles à l'Homme. Elle a été
trouvée porteuse de bactéries identiques à Rickettsia
slovaca en Arménie en 1974 (Rehacek
et al, 1977).
Sa morsure occasionne surtout
des réactions allergiques.
Sa période d'activité principale est estivale.
Photo http://www.zoetecnocampo.com/jump/jump.cgi?eimeria.chez.tiscali.fr/Ectoparasites/argas.html
Argas vespertilionis
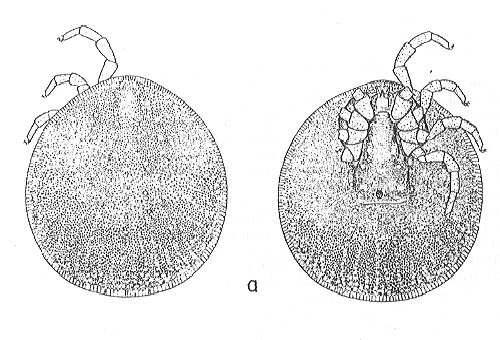 C'est
une tique cavernicole, inféodée aux chauves-souris, on la trouve
fréquemment dans les grottes et les creux de rochers. Elle est présente
pratiquement sur tout le territoire national à moins de 900 m d'altitude,
et dans tous les pays limitrophes.
C'est
une tique cavernicole, inféodée aux chauves-souris, on la trouve
fréquemment dans les grottes et les creux de rochers. Elle est présente
pratiquement sur tout le territoire national à moins de 900 m d'altitude,
et dans tous les pays limitrophes.
L'espèce est spontanément porteuse de Coxiella
burnetii. Si l'on exclut sa morsure allergisante, son rôle pathogène
est inconnu pour l'Homme.
Les larves et nymphes actives en automne hiver, les adultes surtout en août.
Gravure http://infovet.chonnam.ac.kr/vetparasitology/vetpar/laboratory/Tickkey/others/Argas_vespertilionis(ma,fe).htm
Ornithodoros coniceps
Comme Argas reflexus, c'est une espèce rencontrée dans
les pigeonniers, qui ne rechigne pas à envahir les habitations pour
piquer les occupants. En France, elle a une répartition méridionale,
assez limitée. Des morsures sont relatées chez l'homme en France
et en Espagne, essentiellement chez des personnes ayant séjourné
dans les rochers et les grottes occupées par des pigeons bisets (Gil
Collado, 1947; Keirans, 1984).
Outre les allergies provoquées par sa morsure, son rôle
pathogène mal connu.
Toutes les stases ont une activité verno-estivale.
Ornithodoros capensis
Sous-espèce d'O. coniceps, parasite les oiseaux de
mer qui le transportent dans le monde entier. On peut le trouver dans toutes
les zones de nidification françaises (côtes de la Manche et de
l'Atlantique, en passant par la Bretagne). Il est connu pour être porteur
du virus du West Nile (WNV), mais son rôle pathogène pour l'homme
n'est pas mieux connu que celui d'O. coniceps.
Des morsures d'O. capensis maritimus sont régulièrement
rapportées en France, cette tique commune chez les oiseaux de mer de
tout le littoral français. Elle transmet le virus Soldado qui pourrait
occasionner un problème de santé publique, là où
prolifèrent les goélands en zone urbaine ; elle est également
porteuse du virus Meaban [194,195].
Toutes les stases sont actives de mai à juillet.
Tableau des Arboviroses transmises par les tiques en France
Dernière mise à jour : le 27 12 2009
Remerciements à Cl. Pérez-Eid et B. Pesson